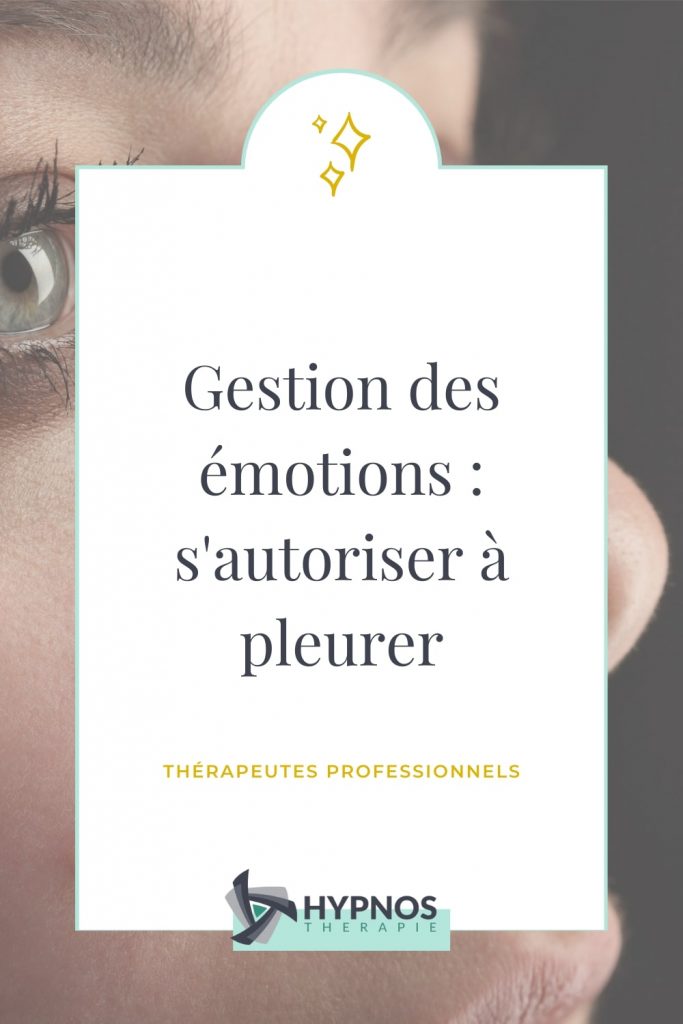Tabou dans notre société, l’acte de pleurer se déroule souvent dans le secret de notre intimité. De nos parents qui cherchaient à tout prix à faire taire nos larmes, à nos amis qui s’en sont moqués, sans oublier la “société” qui l’associe à un signe de faiblesse et à un acte de victimisation (qui est pourtant un processus psychologique bien particulier) nous ne sommes pas libres de pleurer. Pourtant, les bénéfices d’une session de pleurs – dans le cadre d’une pratique intime ou d’une thérapie par hypnose – sur notre état émotionnel et psychologique sont réels. Voyons ensemble pourquoi nous pleurons si peu, et pourquoi nous devrions nous autoriser à pleurer plus souvent.
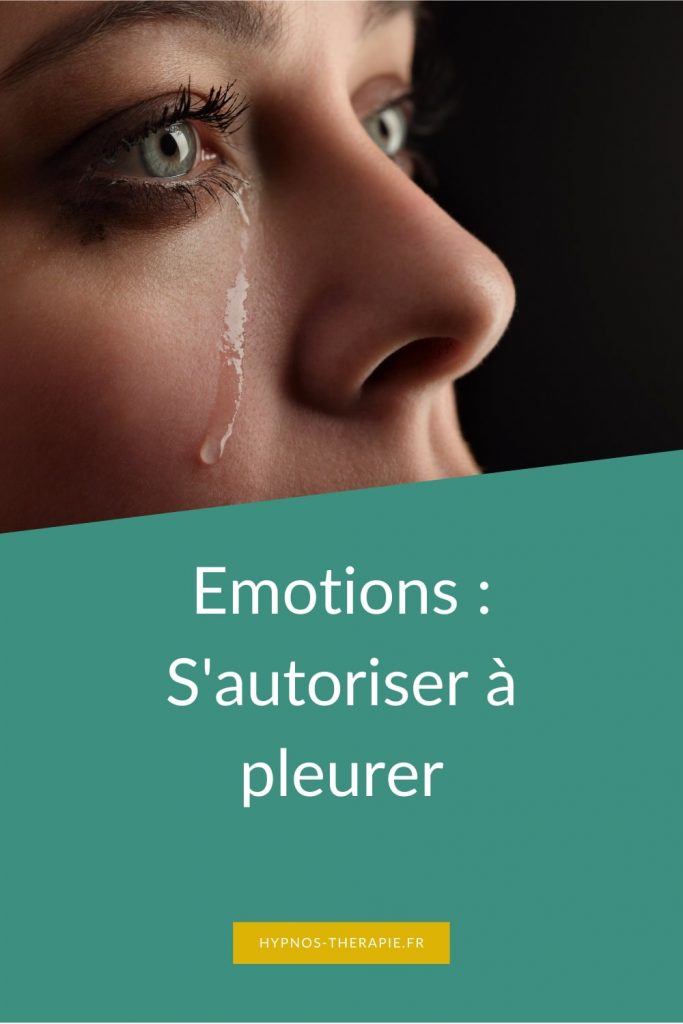
PLEURER, UN SIGNE DE FAIBLESSE ?
Les larmes de l’enfant
Dès la naissance de leur bébé, la question de l’interprétation des pleurs se pose. Premier mode de communication de l’enfant avec ses parents, les pleurs plongent les parents dans un état d’alerte maximal où ils cherchent à les décoder correctement : douleur ? faim ? chagrin ? cauchemar ? Qu’est-ce qui fait donc pleurer mon enfant ? Les parents sont alors tournés vers un seul objectif : mettre fin aux larmes de leur enfant.
Ainsi, plus l’enfant grandit et progresse dans le langage, moins il est autorisé à pleurer : “Tu n’es plus un bébé !” Cette réduction du droit à pleurer vient peut-être du fait que ces pleurs d’enfant rappellent aux adultes leurs propres souffrances enfouies, leurs traumatismes anciens.

Homme ou Femme : une relation aux larmes différente
Des études statistiques ont récemment conforté ce que nous avons tous pu observer : les femmes pleurent plus que les hommes. On y apprend ainsi que les femmes pleurent 3 à 6 fois plus que les hommes : 30 à 64 fois par an pour les femmes, contre 6 à 17 fois par an pour les hommes. Particulièrement significatif, cette répartition se dessine à l’adolescence… Ainsi, les enfants garçons et filles pleurent autant, de manière indifférenciée, et l’écart se creuse vers 12/13 ans, âge auquel le rapport à l’autre et la question de l’identité émerge fortement dans la conscience.
L’adolescence est un moment privilégié pour aborder avec l’hypnose son rapport au monde et sa quête d’identité. Prendre conscience de son droit à pleurer à cet âge-là est fondamental dans le développement de l’enfant.
La théorie la plus probable trouve sa source dans le mode éducatif, encore très genré, où l’homme est moins autorisé que la femme à exprimer sa vulnérabilité. On attend de lui une réelle capacité à canaliser ses émotions fortes, tandis qu’on tolère mieux les larmes féminines, même dans des situations de type professionnelles. Damien Maya vous dévoile quelques détails physiologiques assez surprenant, dans sa vidéo au sujet des larmes.
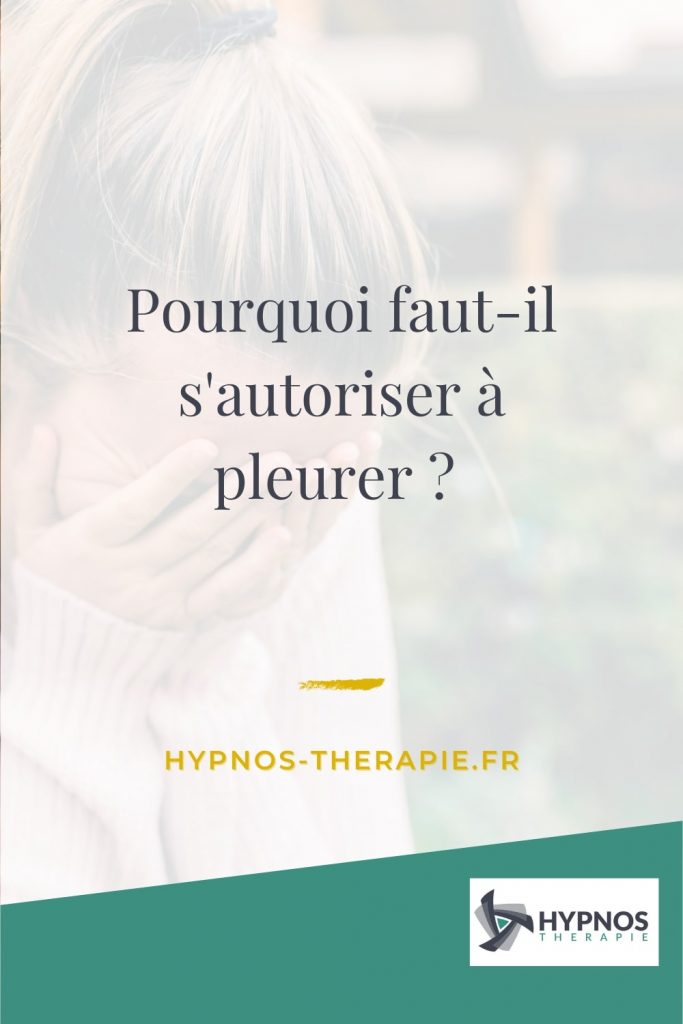
QUE SE PASSE-T-IL SI L’ON NE PLEURE PAS ?
Le point de vue de la psychologie
« Si l’on ne nous laisse pas manifester ce sentiment [de tristesse], si l’on ne peut ouvertement exprimer à fond sa douleur, les sentiments « s’engourdissent » et, passé un moment, la dépression s’installe. »
– Arthur Janov, théoricien du cri primal
Enfouies, dissimulées aux autres autant qu’à nous-mêmes, refoulées, nos émotions fortes et légitimes ressurgissent ensuite de manière incontrôlées face à une scène (de film, par exemple), ou à l’écoute d’une musique, et nous avons du mal à les comprendre. Souvent, ces événements réveillent inconsciemment des blessures profondes créées par des traumatismes telles que des ruptures amoureuses. De plus, au fil du temps, nous assistons à une dégradation importante de l’estime de soi et de la capacité à être acteur de son bonheur.
Devenir tolérant avec soi et les autres
En accueillant nos émotions intenses, comme notre tristesse comme notre enthousiasme, en leur réservant un espace intime d’expression, nous vidons la “soupape” régulièrement, pour éviter tout débordement de stress et d’anxiété. Plus détendus, nos problèmes d’insomnie, nos maux de tête chroniques disparaissent.
Plutôt que déverser notre colère sur les autres, nous la laissons partir lors d’un moment sécurisant où nous sommes seul, ou accompagné par un thérapeute. Plus serein, plus équilibré, nous acceptons alors nos faiblesses et devenons, par conséquent, plus tolérants vis-à-vis des autres et de leurs émotions.
De plus, nous nous concentrons davantage sur notre santé et ce qui nous fait du bien : nous replaçons notre bien-être au cœur de notre quotidien, apprenons à mieux nous connaître et nous mettons en chemin pour réaliser notre mission de vie. Une fois que vous avez appris à pleurer, vous pouvez formuler des projets qui aujourd’hui vous semblent encore fous, comme arrêter de fumer ou prendre votre besoin de maigrir en main !